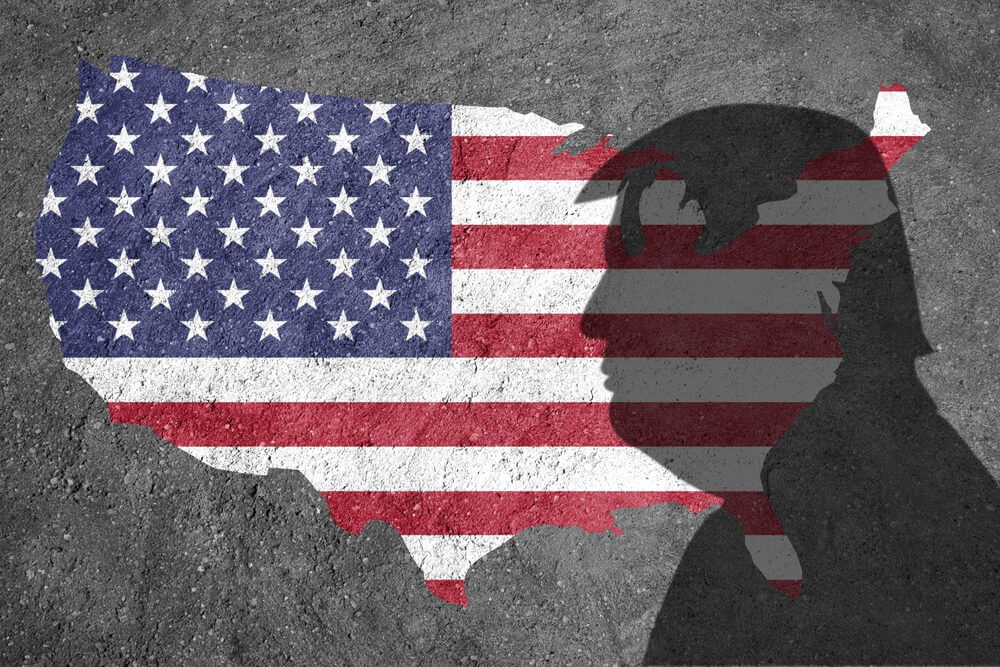L’hiver s’annonce compliqué, notamment en Europe. En l’absence d’un changement de président en Russie (le seul espoir à ce stade de mettre fin à la guerre en Ukraine), les prix de l’énergie resteront très élevés, en particulier dans les pays les plus dépendants du gaz. Ce qui signifie à son tour une pression inflationniste persistante, un nouveau resserrement de la politique monétaire et une tendance à la baisse des bénéfices des entreprises: une combinaison peu favorable pour les marchés financiers. Pourtant, les indices boursiers n’ont pas connu de vente massive, les investisseurs continuant apparemment à « acheter sur faiblesse ».
Pour l’Europe, la question cruciale à l’approche des mois les plus froids sera bien sûr de savoir ce que la Russie décidera de faire de ses livraisons de gaz par les différents gazoducs existants. Il est vrai que le transport de gaz ne peut pas, contrairement au pétrole, être facilement détourné vers des régions du monde plus « amicales ». En outre, la Russie a besoin de revenus pour continuer à financer sa campagne militaire. Mais vendre une quantité moindre de gaz à l’Europe à un prix plus élevé (via Gazprom) semble jusqu’à présent s’être avéré une aubaine pour le président Poutine. Exprimé en termes d’équivalent-pétrole, le gaz européen est actuellement six fois plus cher que l’or noir, alors qu’il a toujours été beaucoup moins cher. Cela signifie bien sûr, et malheureusement pour les objectifs d’émission de CO2 , qu’il est logique d’utiliser le pétrole (et même le charbon) pour produire de l’électricité. À court terme, c’est probablement le seul moyen, outre la réduction de la consommation d’électricité, de réduire le risque de pannes de courant si la Russie fermait complètement les vannes. Il est clair que l’énergie nucléaire fait également un retour « politique », mais la construction de nouvelles centrales est un processus de (très) longue haleine. Et les sources d’énergie renouvelables, telles que les éoliennes et les panneaux solaires, restent encore un facteur relativement marginal dans notre approvisionnement énergétique.
Pour tenter de limiter l’impact sur les consommateurs et le risque d’agitation sociale qui en découle, les différents gouvernements s’emploient à mettre en place des programmes de subventions. Malheureusement, à l’instar des chèques Covid, ces programmes ont tendance à être indifférenciés et à ne pas suffisamment cibler les segments de la population qui ont le plus besoin d’un soutien financier. Il est également de plus en plus question de taxer les « superprofits » des producteurs d’énergie, une mesure qui peut sembler bonne politiquement mais qui ne sera pas facile à mettre en pratique. Prenons l’exemple des parcs éoliens et des installations de panneaux solaires. Dans de nombreux cas, ils ont été construits sur la base d’une vente à terme de l’électricité, parfois pendant 20 ans. Ceci, afin de garantir des prêts bancaires pour leur construction et pour que les investisseurs puissent compter sur un flux de revenus prévisible provenant de la production d’électricité. Ces modèles commerciaux impliquent que les « superprofits » ne sont pas le fait des producteurs d’électricité, mais d’un ensemble de grands clients industriels – beaucoup plus difficiles à identifier et à taxer – qui, à l’époque, achetaient l’électricité à un prix fixe.
La faiblesse de l’euro par rapport au dollar américain est une autre conséquence de la plus grande vulnérabilité énergétique de l’Europe (et de son statut de « canard boiteux » militaire). De l’autre côté de l’Atlantique, grâce à la révolution du pétrole de schiste, la hausse des prix de l’énergie – et donc de l’inflation – semble plus gérable. Néanmoins, il est peu probable que la Réserve fédérale change de position de sitôt, le marché du travail tendu entraînant une hausse des salaires et les loyers étant également en hausse. La trajectoire des taux d’intérêt est donc à la hausse dans un avenir prévisible, même si l’économie américaine est déjà officiellement entrée en récession technique avec deux trimestres consécutifs de baisse du PIB.
Quant à la Chine, dont la forte croissance a permis à l’économie mondiale de sortir de la grande crise financière de 2008-2009, elle reste embourbée dans ses problèmes immobiliers et dans le sentiment négatif des entreprises et des consommateurs, après avoir vécu pendant deux ans et demi avec de durs restrictions liées au Covid. La politique inébranlable de zéro Covid des autorités chinoises est, il faut le dire, de plus en plus difficile à comprendre. S’agit-il d’éviter une épidémie majeure à l’approche du congrès d’octobre du Parti communiste ? Les vaccins chinois ne fonctionnent-ils pas correctement ? Ou bien les décideurs politiques savent-ils quelque chose sur le virus qui a pris naissance dans leur pays que nous, occidentaux, ignorons ? Quelle que soit la réponse, il ne faut pas compter sur le moteur de croissance chinois de sitôt. Le contexte économique mondial laisse donc clairement présager un ralentissement de la croissance, voire une récession.
Jusqu’à présent, les bénéfices des entreprises ont bien résisté, mais nous craignons que le tableau ne soit complètement différent au dernier trimestre de cette année, notamment pour les entreprises européennes. Les prix élevés de l’énergie et la hausse des salaires, associés à la baisse de la demande, constituent un cocktail toxique pour les entreprises, dont les marges bénéficiaires vont fondre comme neige au soleil. Hausse des taux d’intérêt (peut-être à des niveaux bien supérieurs à ce que la plupart des investisseurs semblent prendre en compte) et diminution des bénéfices des entreprises : l’exact opposé de ce qui a prévalu ces dernières années, même pendant la pandémie. Il n’est donc pas difficile de prévoir que les marchés financiers resteront volatils à l’approche de la fin de l’année. La forme de « crash salami » que nous connaissons depuis janvier devrait se poursuivre, avec une alternance de baisses quotidiennes (brutales) et de rebonds quotidiens (moins importants). Cela a beaucoup à voir avec l’attitude « d’achat sur faiblesse » qui prévaut encore dans la communauté des investisseurs.
Pour l’avenir, nous pensons qu’une stratégie de « vente en cas de rebond » est plus appropriée à ce stade du cycle de marché. Nous avons donc ajusté nos portefeuilles depuis un certain temps déjà, en protégeant notre exposition aux actions (par le biais de stratégies d’options), en réduisant notre exposition à l’Europe, en nous concentrant sur les entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix élevé et en réduisant notre duration obligataire suffisamment tôt pour ne pas trop souffrir de la hausse des taux d’intérêt. Mais il faut appeler un chat un chat : personne – nous y compris – ne peut gagner de l’argent dans des marchés en baisse au niveau mondial.
Notre leitmotiv est de protéger autant que possible le capital de nos portefeuilles, tout en conservant une exposition suffisante aux marchés financiers en cas de retournement soudain de la conjoncture actuelle. Deux chevaux sur lesquels parier…