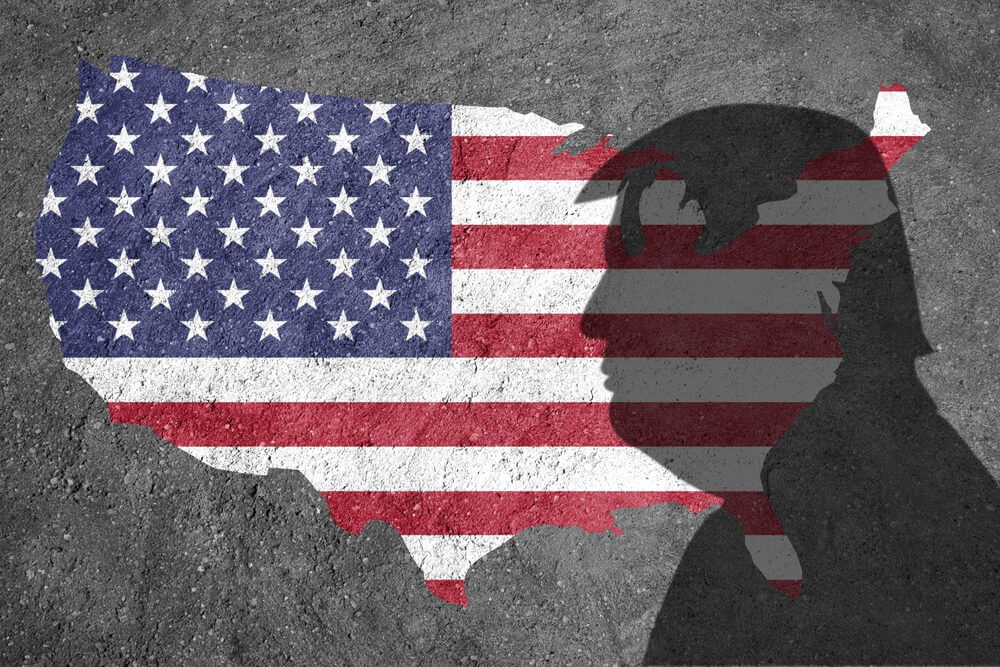Le moment n’est peut-être pas encore venu de faire basculer les portefeuilles actions vers les obligations, mais certains secteurs du marché des titres obligataires deviennent certainement attrayants. Et nous ne parlons pas des obligations d’État américaines, dont les rendements (certes maintenant élevés) perdent une partie de leur attrait si l’on tient compte du risque de change pour les investisseurs européens. Nous n’envisagerions pas non plus les obligations souveraines européennes, la BCE étant en retard dans la remontée des taux et la situation de l’inflation étant particulièrement inquiétante sur notre continent. Non, c’est l’exposition au crédit européen que nous recherchons aujourd’hui, mais de manière sélective et en nous concentrant sur les émetteurs investment grade aux bilans solides.
Il est difficile de ne pas commencer cette lettre sans parler de la politique des banques centrales, celle-ci étant le principal – sinon le seul – moteur des marchés financiers cette année. Certains investisseurs espéraient un pivot ? Au contraire, la Réserve fédérale vient de procéder à une nouvelle hausse de 75 points de base, portant la fourchette des fonds fédéraux à 3,75-4 %, son niveau le plus élevé depuis 2008. Et son président Jerome Powell a rejeté toute idée de pause dans le processus de resserrement des taux, même s’il a concédé que le rythme pourrait ralentir à l’avenir. Pendant ce temps, en Europe, la présidente Christine Lagarde a également exprimé la volonté de la BCE de ne pas laisser l’inflation s’installer. Il est toutefois plus difficile de savoir si elle y parviendra, dans la mesure où l’inflation européenne n’est pas seulement un sous-produit d’une demande ou d’une croissance économique trop forte. Elle découle en grande partie de facteurs externes, sur les fronts de l’énergie et de l’alimentation bien sûr, et le marché du travail plus réglementé qui favorise également une spirale salaires-prix plus pernicieuse. Ainsi, alors que la Fed peut se « contenter » de ralentir suffisamment l’économie américaine, à partir des niveaux qui ont été artificiellement stimulés par les mesures de soutien durant et après la pandémie, la tâche de la BCE est beaucoup plus ardue. Le risque étant qu’un resserrement monétaire excessif pousse l’économie européenne vers une grave récession et/ou une crise de la dette.
Le différentiel de politique des banques centrales est clairement ce qui anime les marchés des devises à court terme, d’où l’appréciation incessante du dollar par rapport à l’euro. À plus long terme, toutefois, les considérations relatives à la parité du pouvoir d’achat (PPA) devraient entrer en jeu (même si leur fonctionnement est moins efficace lorsque le commerce mondial n’est pas totalement libre, c’est-à-dire lorsque les pays appliquent – comme aujourd’hui – des mesures protectionnistes). Et selon les calculs de PPA, le billet vert est actuellement surévalué d’environ 20% par rapport à l’euro. Cela signifie, en résumé, qu’un Américain avec un billet de 100 dollars peut acheter 20 % de marchandises en plus en Europe que chez lui. Un écart qui a été dépassé pour la dernière fois en 2000-2001, lors de l’éclatement de la bulle Internet. Avant cela, il faut remonter à 1984 pour trouver une période de plus grande surévaluation du dollar ! En tant que tel, et bien que nous reconnaissions la force habituelle du dollar dans les marchés financiers turbulents, nous pensons que sa hausse actuelle n’est peut-être plus très longue.
Du point de vue de l’investisseur européen, cela suggère que l’achat de bons du Trésor américain n’est pas nécessairement une proposition attrayante compte tenu du risque de perte sur le change. C’est pourquoi nous nous concentrons aujourd’hui sur les opportunités qui se présentent dans le segment obligataire européen. Plus particulièrement dans le crédit aux entreprises de qualité, où les spreads se sont écartés de 95 points de base (pdb) à 220 pdb depuis janvier (Bloomberg Euro Aggregate Corporate option-adjusted spread). Ils se situent désormais à des niveaux similaires à ceux de mars 2020, lorsque la crise du Covid-19 a éclaté. En fait, ce n’est que la deuxième fois depuis 2012 (la fin de la tragédie grecque) que les spreads ont franchi le seuil des 200 pdb, après avoir la plupart du temps évolué aux alentours de 100 pdb.
Investir dans des obligations d’entreprises européennes comporte clairement un risque de duration, le taux « sans risque » étant susceptible de continuer à augmenter à mesure que la BCE durcit sa politique. C’est pourquoi il faut s’attacher à limiter le risque de crédit – en évitant le segment du haut rendement et, dans le segment de l’investment grade (dont l’indice a, notons-le, subi une remarquable correction de 16 % depuis le début de l’année), en sélectionnant soigneusement les émetteurs. Nous nous tiendrons notamment à l’écart des entreprises qui ont considérablement accru leur endettement au cours des dernières années à taux zéro, en particulier lorsque cette émission de dette supplémentaire a servi à racheter des actions plutôt qu’à investir dans des outils de production. En effet, les entreprises qui ont choisi de suivre cette voie risquent d’avoir des difficultés à refinancer les emprunts lorsqu’ils arriveront à échéance. Il convient également de se méfier des entreprises dont l’activité les place dans une situation de désavantage concurrentiel important au niveau mondial, que ce soit en raison d’une consommation d’énergie élevée, de la disponibilité de la main-d’œuvre ou de l’exposition aux réglementations environnementales plus strictes de l’Europe.
En parlant de la santé des entreprises, la saison des résultats du troisième trimester, encore en cours, démontre une fois de plus une bonne dose de résilience. Au niveau des ventes, les surprises positives en Europe sont proches de 90 %, grâce à des revenus gonflés par les prix (et non à des volumes vendus sensiblement plus élevés). Le ratio de surprise positive sur les bénéfices est proche de 50 %, soit un peu moins qu’au cours des trimestres précédents, ce qui témoigne d’une pression à la baisse sur les marges. Les estimations des analystes (et des entreprises) pour 2023 restent généralement trop ambitieuses à notre avis, même si les indices boursiers envisagent clairement un scénario beaucoup plus sombre.
Le fait est que nous nous trouvons dans une situation économique très étrange: ce qui serait autrement une crise très grave (énergie et inflation) est atténué par le soutien que les consommateurs reçoivent des gouvernements, ce qui soutient la demande de produits et de services des entreprises. Au détriment, toutefois, des finances publiques – dont les ratios d’endettement atteignent des niveaux extraordinaires. En d’autres termes, nous dépensons collectivement de l’argent que nous n’avons pas. La question est de savoir combien de temps cela peut durer, comme nous l’avons déjà écrit à maintes reprises. Il y a bien sûr un aspect politique à cette question, notamment aux États-Unis où les élections de mi-mandat risquent de remanier la majorité au Congrès et probablement de mettre un terme aux coûteux plans de soutien aux consommateurs. Il y a aussi un aspect financier, car la dette publique doit être refinancée. Aux États-Unis, environ un tiers de cette dette doit arriver à échéance d’ici à la fin de 2023, ce qui signifie que le coût de la hausse des taux pourrait se faire sentir assez rapidement.
L’UE est dans une meilleure situation à cet égard, car ses différents pays membres ont profité des faibles taux d’intérêt de ces dernières années pour prolonger fortement les échéances de leurs dettes. Mais là aussi, le retour à l’orthodoxie budgétaire prévu à partir de 2024 fera en sorte que les généreuses distributions d’argent appartiennent définitivement au passé.
En somme, plusieurs années difficiles nous attendent. Bien entendu, cela ne signifie pas nécessairement que les investisseurs ne pourront pas obtenir des rendements positifs, bien au contraire. Mais gagner de l’argent ne sera pas aussi facile qu’au cours de la dernière décennie.