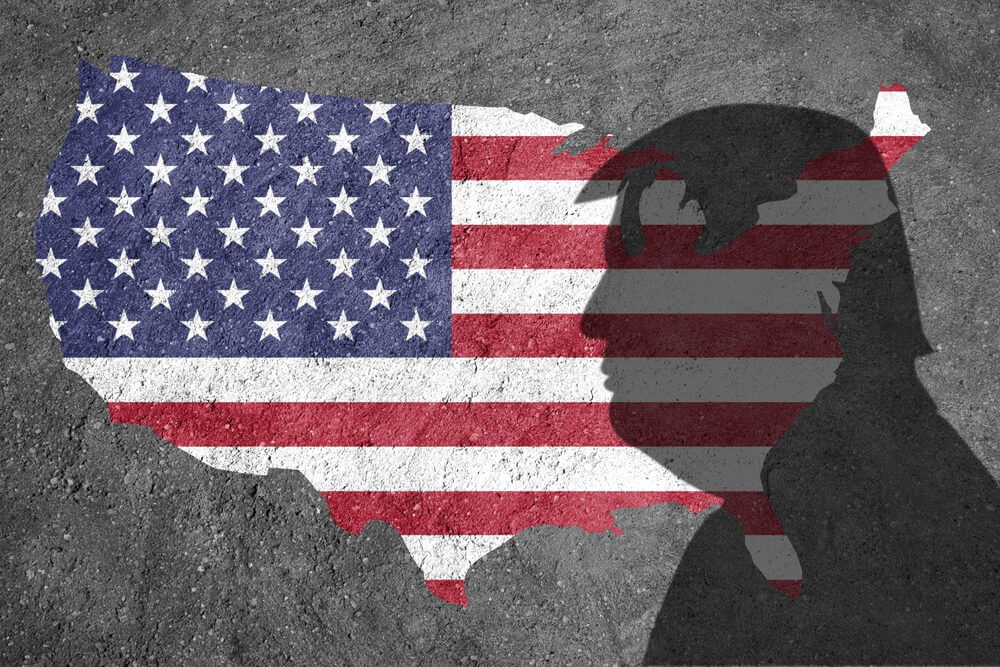Pour l’instant, les banques centrales occidentales s’en tiennent à leur objectif d’inflation de 2%. Il pourrait toutefois s’avérer difficile d’atteindre cet objectif sans provoquer de récession. La combinaison d’effets de second tour (la répercussion de la hausse des salaires sur les prix à la consommation), d’un marché du travail tendu et de prix des matières premières à nouveau en hausse, rendra particulièrement difficile la tâche des banques centrales de freiner le fantôme de l’inflation tout en permettant une baisse des taux d’intérêt. Un déplacement de l’objectif officiel d’inflation à 3% pourrait ne pas être une mauvaise idée – et être particulièrement bienvenu lorsqu’il s’agit de la viabilité d’une dette publique croissante.
Il y a six mois, dans notre Lettre d’investissement, nous écrivions que si le pétrole avait été un facteur favorable à la baisse de l’inflation pendant une bonne partie de l’année 2023, le prix du Brent était remonté à 90 USD, niveau auquel il s’était négocié au cours des derniers mois de 2022. Les effets de base positifs étaient donc sur le point de disparaître et, en l’absence d’une baisse de son prix, le pétrole devrait avoir un impact plutôt neutre sur la jauge de l’inflation au cours des trois derniers mois de 2023 et même contribuer à la faire augmenter à partir de 2024. Les données récentes ont certainement corroboré cette prédiction, le taux annuel de l’IPC américain passant de 3,1% en novembre 2023 à 3,5% en mars 2024.
Mais à moins que la situation géopolitique ne s’aggrave dramatiquement et que les prix de l’énergie ne s’envolent, le plus grand obstacle pour gagner la bataille de l’inflation se trouve ailleurs. Comme nous, les banques centrales sont sans doute actuellement très attentives aux négociations salariales et à la montée en puissance des syndicats. À cet égard, l’accord conclu fin avril entre l’United Auto Workers (UAW) et Daimler Truck est particulièrement instructif. L’UAW a négocié une augmentation du salaire général minimum de 25% sur une période de quatre ans, dont 16% la première année (10% immédiatement, 3% dans six mois et 3% dans douze mois). En outre, pour la première fois dans l’histoire de Daimler, les travailleurs bénéficieront d’une protection contre le coût de la vie. L’UAW affirme également avoir obtenu une « plus grande sécurité de l’emploi » (grâce à la garantie d’une construction minimale de véhicules dans chaque usine).
La manifestation de ces mécanismes de second tour, par lesquels les hausses de prix se répercutent sur les salaires, est ce qui rend si difficile la dernière étape de la désinflation. D’autant plus que les travailleurs réclament des augmentations de salaire après deux décennies au cours desquelles la rémunération des employés a, en moyenne, augmenté plus lentement que le rendement du capital. Ainsi, alors que le marché du travail est tendu et risque de le devenir encore plus en raison des effets démographiques, des restrictions migratoires et de la mise en place de barrières commerciales (dans le cadre de la politique dite de « reshoring » en Occident), il semble que nous ne soyons pas encore à la fin d’une longue période d’augmentations salariales.
Et ce n’est pas seulement avec leurs employés que les entrepreneurs devront partager le gâteau plus généreusement à l’avenir. Les gouvernements, eux aussi, ont un appétit croissant pour les revenus, compte tenu de l’aggravation de leur situation budgétaire et de l’augmentation de leur dette. L’impôt sur les sociétés est donc généralement orienté à la hausse, et les prochaines élections pourraient accentuer la pression. Notons à cet égard qu’il est déjà question de relever le taux d’imposition minimum de 15% de l’OCDE sur les entreprises multinationales, qui n’est entré en vigueur que cette année, pour le porter à 25%…
En ce qui concerne les marchés financiers, il est fascinant de constater qu’ils n’envisagent aujourd’hui qu’une ou deux baisses potentielles des taux cette année aux États-Unis, alors qu’ils en attendaient sept il y a quelques mois à peine. Et ce changement s’est produit sans qu’il y ait eu de correction boursière correspondante.
La solide performance des actions depuis le début de l’année face à la hausse des rendements des obligations d’État (le rendement du Trésor américain à 10 ans est passé de 3,9% au début de l’année à 4,5% aujourd’hui) semble trouver son origine dans les estimations nettement plus élevées des bénéfices des entreprises et dans l’absence de récession économique. En conséquence, la prime de risque pour un investissement en actions est tombée à des niveaux historiquement bas. Pour que le marché boursier évite une correction, il faudra soit que les prévisions de bénéfices soient validées (voire dépassées), soit que les taux d’intérêt baissent.
En ce qui concerne les bénéfices, les prochaines saisons de résultats trimestriels seront donc cruciales. Nous craignons que la barre ait été placée relativement haut. Les analystes s’attendent actuellement à une croissance globale des bénéfices d’environ 10% pour l’indice MSCI World en 2024. Et si l’on en croit la réaction des actions individuelles aux résultats inférieurs au consensus, la tolérance du marché à l’égard des chiffres « décevants » est très faible.
En ce qui concerne la trajectoire des taux d’intérêt, bien qu’il n’y ait actuellement aucune justification économique de premier ordre pour que la Réserve fédérale desserre son emprise monétaire, la pression politique en faveur d’une baisse des taux s’intensifie. Le paradoxal « Inflation Reduction Act » a alimenté les dépenses publiques (et l’économie), l’accumulation des déficits budgétaires se traduisant par une dette publique toujours plus importante – dont le service s’avérera difficile à assurer aux niveaux actuels de taux d’intérêt « élevés ».
La Banque centrale européenne est soumise à la même pression (principalement à cause de la France et de l’Italie) et a indiqué qu’elle commencerait à baisser ses taux dès le mois de juin. Si elle tient parole, l’euro risque de s’affaiblir temporairement par rapport au dollar, ce qui est inflationniste étant donné l’importance des importations européennes d’énergie qui sont payées en dollars. Pour les exportations, une baisse de l’euro serait positive, mais la question est de savoir dans quelle mesure cela profiterait à l’Europe dans le contexte actuel, plus protectionniste, où les barrières commerciales ont été rétablies partout dans le monde.
En conclusion, le moment ne semble pas venu d’investir une part encore plus importante des portefeuilles dans les actions, dont le risque par rapport aux obligations n’est pas (ou peu) rémunéré. Les obligations restent toutefois attrayantes avec, entre autres, les bons du Trésor américains à long terme qui offrent un rendement intéressant.